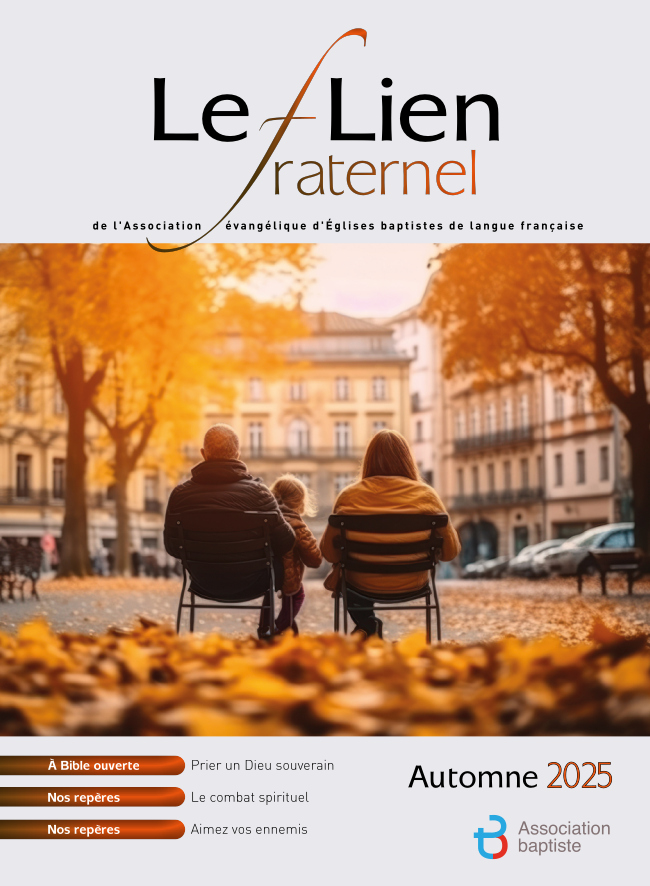Prier un Dieu souverain (2) La pratique de la prière

Cet article fait suite à celui paru cet été. Lors de la Pastorale 2025, Thierry Huser avait présenté un exposé intitulé « Prière et souveraineté de Dieu ». Le premier article explicitait ce que l’on entend par « souveraineté de Dieu » et tentait de dire le sens de la prière à cette lumière. Celui-ci développe les incidences de la souveraineté de Dieu sur la pratique de la prière.
La souveraineté de Dieu est le fondement et la force de nos prières. Bien comprise, elle encourage à la foi, à la confiance, et au repos en Dieu. Elle valorise la bonté et le soin qu’a le Seigneur de ses créatures et de ses enfants. Elle invite, par la prière, à trouver en Dieu « toute la plénitude de ses bénédictions et largesses, afin que de là, comme d’une fontaine très pleine, nous en puisions tous. » (Calvin, Institution Chrétienne III, xx, 1). Elle doit aussi déterminer notre attitude dans la prière, et ce sous plusieurs angles.
Un fondement de la prière
Sans un Dieu souverain, il n’y a pas de prière possible. La plus simple prière requiert cette souveraineté. Lorsque l’on demande à Dieu de faire aboutir une candidature à un poste, on suppose un Dieu capable d’agir sur le regard et la décision d’un certain nombre de personnes, et de créer des convergences entre une demande et une situation. Seul un Dieu pleinement souverain peut agir ainsi ! Il en est de même lorsque l’on prie pour les personnes, pour leur changement, leur conversion. L’attitude même de la prière, où l’on se met au deuxième plan pour laisser Dieu agir, confesse cette souveraineté, et parfois s’y abandonne. Même lorsque l’on prône l’engagement dans la prière, il faut garder le sens du contraste entre la part de nos paroles et la part totalement décisive de l’action de Dieu. Nous pouvons « crier » à Dieu, l’invoquer avec force : l’intensité de notre prière montre l’intensité de ce que Dieu doit faire, et non la force de notre parole ! Il faut ici dénoncer comme totalement creux tout le discours sur la puissance qu’aurait notre propre proclamation : seule l’action de Dieu est efficace, seule sa parole est créatrice. « Gardez-vous de penser qu’à force de paroles vous serez exaucés. » (Mt 6.7).
Une invitation à l’humilité
La conscience de la souveraineté de Dieu nous invite à l’humilité. Dieu est attentif à nos cris. Mais il répond selon sa volonté propre. Il n’est jamais ligoté par nos demandes. Cette dimension d’humilité est partout présente dans la Bible, jusque dans les prières les plus hardies et les plus engagées : Abraham (Gn 18-27-32), Daniel (Dn 9.18-19), Habaquq (Ha 3.2). Jamais, dans la Bible, Dieu n’est instrumentalisé, mis au service de « notre » volonté, de « notre » foi, de « notre » parole. Il est le Seigneur auquel nous adressons notre prière. Lorsque nous venons à Dieu, sa pensée n’est pas une « table rase », qui n’attendrait qu’à s’imprimer de nos requêtes : le Seigneur a déjà ses propres pensées. « Qui l'a éclairé de ses conseils ? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction ? Qui lui a appris le sentier de la justice ? Qui lui a enseigné la sagesse, et fait connaître le chemin de l'intelligence ? » (Es 40.13-14, cf. Rm 11.34).
La convergence des volontés
Notre prière doit viser la convergence des volontés, entre celle de Dieu et la nôtre. Nous avons la liberté de « faire connaître nos besoins » (Ph 4.6). Mais le but est de nous permettre d’entrer en convergence avec Dieu : « Que ta volonté soit faite ! » (Mt 26.39,42 ; cf. 6.9-10). L’exemple le plus parlant est la prière de Jésus à Gethsémané. Par la prière, il entre volontairement dans le projet du Père, avec tout ce que ressent et redoute son âme. Il est fortifié, renouvelé, pour faire cette volonté. Il sera exaucé à cause de son attitude respectueuse (Hé 5.7-10) : sa mort et sa résurrection fondent désormais le salut en lui.

Une relation qui nous construit
La prière qui respecte la souveraineté de Dieu est une relation dans laquelle nous sommes construits. Dans ce dialogue, un travail s’effectue en nous : on s’ouvre à la volonté de Dieu, des enjeux se clarifient, on discerne ce que Dieu attend, la présence de Dieu nous renouvelle. Ne réduisons jamais la prière au simple moyen d’obtenir quelque chose : nous avons aussi, nous-mêmes, à y être transformés. « Son visage ne fut plus le même », est-il dit d’Anne après qu’elle s’est approchée de Dieu (1S 1.19). Plusieurs psaumes illustrent le cheminement qui s’opère dans la prière : il faut le temps de la prière pour entrer dans la confiance (Ps 31), surmonter craintes et angoisses (Ps 25), saisir le pardon (Ps 51), dépasser les réactions passionnelles (Ps 139.19-24). À Gethsémané, Jésus a cheminé authentiquement. Il passe de l’effet « repoussoir » de la Passion (« s’il est possible que cette coupe s’éloigne de moi », Mt 26.39) à l’acceptation (« s’il n’est pas possible… que ta volonté soit faite », Mt 26.42). Le vis-à-vis avec le Dieu souverain laisse toujours un espace pour la relation qui transforme.
La Parole de Dieu, ancrage et orientation
La Parole de Dieu nous est donnée pour ancrer et orienter nos prières dans la ligne de la pensée de Dieu. Les grandes prières de la Bible nous en donnent l’exemple (Né 1 et 9 ; Dn 9). Ces prières s’appuient sur l’intégralité de la Parole de Dieu, et ne se contentent pas d’un simple fragment isolé. Elles rappellent les commandements de Dieu, son alliance, sa fidélité. Parfois, elles contiennent toute l’histoire du salut, pour bien s’ancrer dans le grand dessein de Dieu. Elles s’appuient, fermement, sur les promesses du Seigneur. Elles mentionnent les qualités de Dieu, ses actions passées. La « Parole de Dieu dans toute sa richesse » (Col 3.16) nourrit les grandes prières de la Bible.
Certains, aujourd’hui, affirment qu’il faudrait distinguer bibliquement deux formes de la « Parole de Dieu » en s’appuyant sur deux mots différents employés en grec : logos et rhèma. La Parole de Dieu contenue dans l’Écriture, identifiée à la Parole logos, donnerait un ensemble de vérités générales. La parole rhèma serait, quant à elle, une parole de Dieu particulière, donnée à un individu pour une situation précise. On identifie cette parole à l’épée de l’Esprit d’Éphésiens 6.17 à propos de laquelle Paul emploie justement le mot rhèma. Dans la prière et le combat spirituel, seul compterait le rhèma, cette parole donnée par Dieu pour l’instant présent, que l’on proclame avec puissance. La Parole logos, contenue dans la Bible, est considérée comme bien trop généraliste pour réellement porter et orienter la prière.
Au siècle dernier, le pasteur sud-coréen Yonggi Cho a fortement popularisé cette distinction. Il l’assortissait de tout un propos sur la puissance créatrice de la parole et de l’imagination créative : « J’ai proclamé la parole et elle a créé » ; « Jésus est lié par vos lèvres et vos paroles. » Nous pouvons, par elles, « incuber notre avenir et donner naissance aux résultats » (Yonggi Cho, La quatrième dimension, Vida, 1979, p. 40, 75-96).
On se rend compte des enjeux : avec le poids accordé à ce rhèma, la norme de la prière devient la subjectivité d’une conviction transformée en proclamation efficace. Pourtant, rien ne soutient une distinction entre logos et rhèma dans les textes bibliques. Un examen attentif des usages montre que les deux termes sont totalement interchangeables.
Quelques exemples dans la traduction grecque de l’Ancien Testament :
- Exode 34.27 : L'Éternel dit à Moïse : Écris ces paroles (rhèmata) ; car c'est conformément à ces paroles (logoi) que je traite alliance avec toi et avec Israël.
- Exode 34.28 : L'Éternel écrivit sur les tables les paroles (rhèmata) de l'alliance, les dix paroles (logoi).
- Les dix commandements sont appelés « logoi » en Ex 34.28 et « rhèmata » en Ex 31.1. • 1R 12.24 : Ils écoutèrent la parole (logos) du Seigneur et s'en retournèrent pour marcher selon la parole (rhèma) du Seigneur.
Par ailleurs, rhèma peut être employé pour une parole générale : « Quand Jésus eut achevé tout son discours (rhèmata) devant le peuple, il entra dans Capharnaüm. » (Lc 7.1). Et logos est employé pour une parole très particulière : « Dis un mot (logos) et mon serviteur sera guéri ! » (Mt 8.8). L’inverse de ce que propose la théorie !
La distinction est donc totalement arbitraire, et surimposée au texte biblique. Certes, il est possible que le Seigneur nous mette à cœur une pensée ou une parole dans le cadre de la prière ou d’un temps où nous nous plaçons à son écoute. Mais rien dans le texte biblique ne nous autorise à accorder à une telle parole une autorité comparable à celle de l’unique Parole de Dieu. L’épée de l’Esprit dont parle Paul, c’est l’Écriture, prise dans son ensemble. C’est elle que nous sommes invités à nous approprier dans la prière avec l’aide et le discernement de l’Esprit saint. C’est elle qui exerce sa fonction normative sur nos prières, nous donne ses orientations, nous fortifie de ses promesses, nous permet de prier avec foi.
La liberté de Dieu
Reconnaître la souveraineté de Dieu, c’est aussi laisser à Dieu la liberté de dire « non » à nos prières. Ce n’est pas la marque principale de sa souveraineté : le Seigneur aime répondre positivement à notre prière. Mais il a la liberté de dire « non » à certaines requêtes. Moïse l’a expérimenté, lui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il « supplie » de pouvoir entrer dans le pays promis (Dt 3.23). Mais le refus est net : « Le Seigneur m’a dit : cela suffit ! Ne me parle plus de cette affaire. » (Dt 3.26). Il fallait souligner la faillibilité de Moïse, manifestée lors de l’épisode du Rocher (Nb 20) : seul le Christ, nouveau Moïse, ne péchera pas. C’est peut-être, aussi, une grâce, à cent-vingt ans, de ne pas avoir dû s’engager dans les combats de la conquête de Canaan. Le « non » de Dieu, reçu et accepté, a également permis à Moïse de prendre des dispositions et d’équiper Josué.
Le Nouveau Testament nous rappelle que Dieu refuse d’exaucer les prières inspirées par de mauvais motifs : « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » (JC 4.3). Dieu « résiste aux orgueilleux » (JC 4.6) : cela se manifeste aussi dans la prière. Il existe aussi des décisions sur lesquelles le Seigneur ne reviendra pas (Jr 7.16).
Dans sa sagesse, notre Père veille à donner de « bonnes choses » à ses enfants (Lc 11.13). Cela suppose ne pas donner suite à des requêtes mal orientées. Le Seigneur a de la consistance, en face de nos prières, de nos proclamations, de notre foi. Il faut le rappeler, face à certaines prétentions de l’autorité de la parole de foi. Mais nous savons pouvoir nous reposer sur la sagesse et la bonté de notre Dieu, lorsqu’il nous faut accepter que sa décision pour nous ne correspond pas à nos désirs : « Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel ! Mais dans ta colère souviens-toi de tes compassions ! » (Ha 3.2).
Cette limite à prendre en compte ne doit cependant jamais voiler la révélation de Dieu qui parcourt et illumine toute l’Écriture, et qui donne force, élan et confiance à la prière que nous lui adressons : « L’Éternel Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » (Ex 34.6). Il aime notre prière. Il l’attend. Dans sa souveraineté, il y répondra, avec sagesse, amour et générosité.