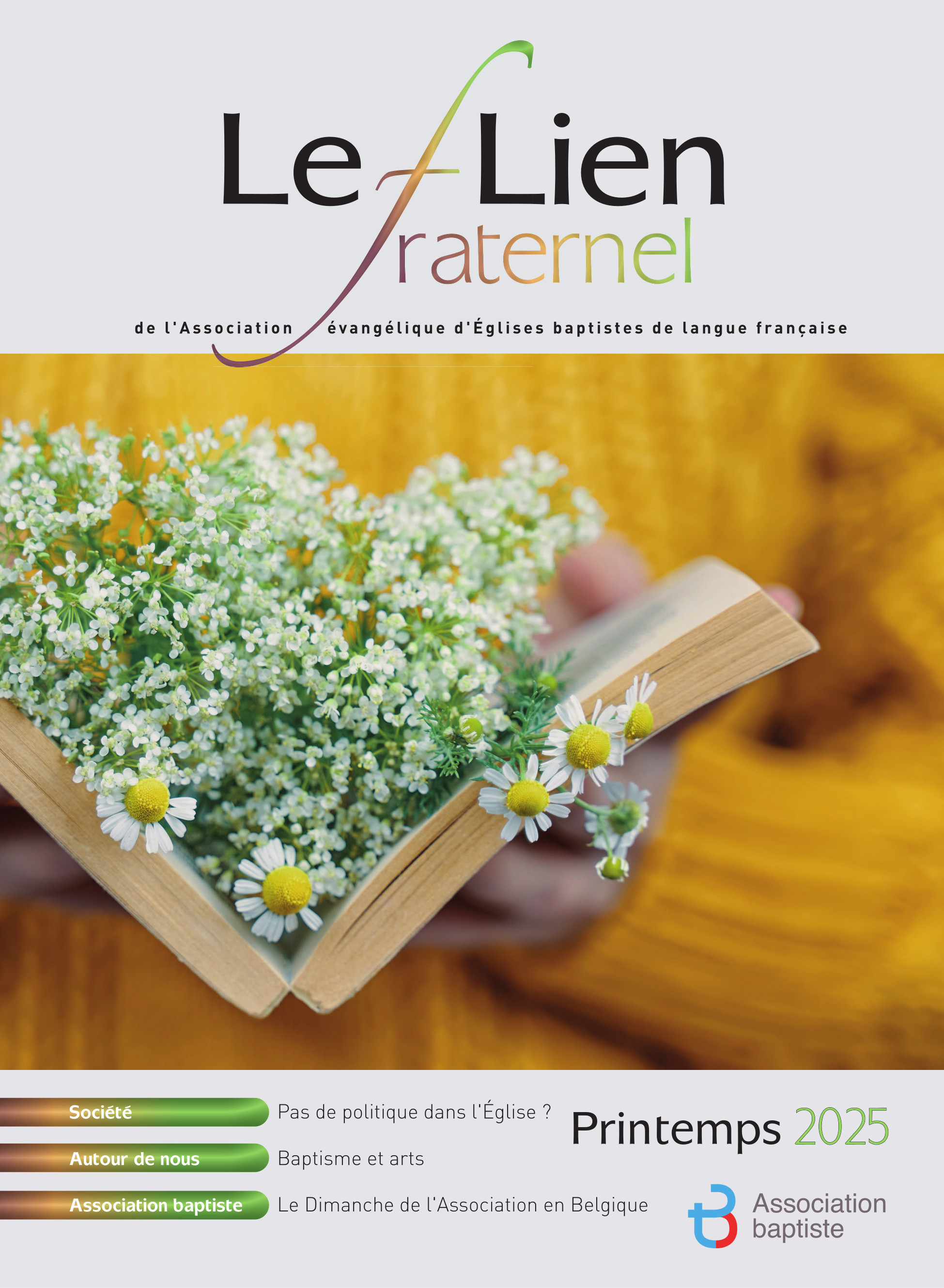Pas de politique dans l’Église ?

Il me semble avoir souvent entendu que « l’Église ne fait pas de politique ». Les excès de prédicateurs appelant ouvertement au vote pour ou contre tel ou tel candidat dans d’autres contextes nous repoussent et nous sommes souvent frileux à aborder des thèmes qui prêtent à division dans nos sociétés. Je crois pourtant qu’il est important que nous osions apprendre à réfléchir ensemble à ces questions dans nos communautés. Il en va de notre unité.
Trois arguments pour la prudence
Soulignons d’abord qu’on peut dégager plusieurs raisons encourageant une certaine prudence à l’égard de la politique dans l’Église.
La première est historique. Si l’on insiste aujourd’hui pour dire que l’Église ne ferait pas de politique, c’est notamment par volonté de contraste avec une très longue histoire de cette collusion entre « le sabre et le goupillon(*) » que chantait Jean Ferrat. Tout n’y est certainement pas noir, mais l’histoire de la chrétienté reste marquée par les alternances de luttes de pouvoir et d’associations entre l’Église et les diverses formes de l’État. S’il y a bien une chose dont nos contemporains ne veulent pas, et dont une saine théologie devrait également nous éloigner, c’est une Église qui voudrait imposer sa vision du monde à la société.
Le royaume auquel nous aspirons en tant que chrétiens n’est pas de ce monde. Cette seconde raison de rester prudent face à la politique est bien plus fondamentale encore que le souci de ne pas inutilement effrayer nos concitoyens. Les royaumes terrestres vont et viennent et les États-nations contemporains ne sont guère que des constructions humaines qui passeront un jour ou l’autre. Nous pouvons nous réjouir ou nous affliger de certains aspects de leur fonctionnement, nous engager dans la promotion de ce qui est bon en leur sein et lutter contre les abus, mais tout cela n’est que temporaire et aucune évolution politique ne pourra nous donner plus que ce que nous avons de plus précieux, ou nous l’enlever. C’est à Christ que nous voulons rester attachés, pas à telle ou telle vision de ce que devrait être ce monde. En ce sens, l’Église et les chrétiens ne pourront jamais s’engager en politique comme si toute leur vie en dépendait. Nous sommes toujours et avant tout citoyens d’une autre cité.

Néanmoins, nous vivons bien dans ce monde et celui-ci vient souvent déchaîner nos passions. C’est probablement là une troisième raison pour laquelle nous conservons une certaine prudence en Église quant aux questions politiques. Nous attendons un autre royaume, mais la situation dans laquelle nous vivons présentement n’est pas sans influence sur nous ou sur ceux que nous aimons. Cela nous réjouit, nous enthousiasme, nous affecte, nous inquiète, nous irrite… On comprend alors peut-être pourquoi nous aurions tendance à vouloir garder ces choses hors de l’Église. Nous le savons : nos situations sont diverses. Ce qui attriste l’un pourrait bien réjouir l’autre, et inversement. Ne risquerait-on pas de mettre en péril notre unité si toutes ces émotions venaient à se rencontrer ? Vu le potentiel explosif de certains sujets, ne vaut-il pas mieux laisser de côté ces choses secondaires pour se concentrer sur ce qui compte vraiment ?
Aux côtés de nos justes raisons théologiques, cette crainte pour notre unité pourrait bien être un facteur majeur dans notre réticence à parler de politique en Église. Mais au-delà d’une raisonnable dose de prudence, cette crainte met aussi en danger la préservation et l’approfondissement d’une réelle unité au sein de l’Église.
Les risques d’une politisation déconnectée de l’Évangile
En effet, s’il y a probablement déjà quelques décennies que, dans notre contexte, « l’Église ne fait pas de politique », les chrétiens n’en sont pas moins politisés. Que notre approche politique de préférence soit de droite, de gauche, du centre, de l’autruche ou un peu de tout cela, nous avons des opinions sur le monde qui nous entoure.
On peut bien entendu espérer que l’écoute hebdomadaire de la prédication de l’Évangile et la lecture et l’étude de l’Écriture contribuent au moins indirectement à orienter et baliser la construction de ces opinions. Mais il ne faudrait pas se faire d’illusions : ces pratiques sont en baisse même dans nos milieux et pourraient bien souvent ne pas peser très lourd face aux divers autres « catéchismes » médiatiques de toutes obédiences auxquels nous nous soumettons plus ou moins volontairement. Dans leurs propos politiques et l’exercice de leur influence, certains autour de nous se montrent bien moins soucieux de retenue que notre sagesse chrétienne.

Assurément, l’Évangile véritable continue à nourrir les idées et les engagements de bien des chrétiens. Mais il est soumis à la concurrence de nombreux autres « évangiles » contemporains, que ceux-ci soient ouvertement séculiers ou passent encore pour chrétiens. On entend aussi régulièrement des utilisations politiques réductrices, sinon abusives, du nom de Dieu ou de la notion de « valeurs chrétiennes ». Si nous ne parvenons pas à aborder ces choses en Église, il y a fort à craindre que la politisation de certains chrétiens se construise sans lien avec leur foi, voire même en contradiction avec celle-ci, qui porte bel et bien des valeurs applicables au champ de la politique. Cet éloignement s’observe notamment quand certains cèdent, dans le fond ou dans la forme, à des postures de haine qui déshumanisent leurs opposants. Lorsque des frères et sœurs se laissent emporter et posséder par telle ou telle tribu ou cause politique, l’Évangile en fait les frais.
Nous sommes pourtant particulièrement bien pourvus contre ces enfermements idéologiques. Dimanche après dimanche, nos communautés rassemblent des hommes et des femmes d’horizons très variés, unis simplement par la foi en l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si elles peuvent certes avoir leurs orientations sociologiques spécifiques, les communautés chrétiennes n’en représentent pas moins très souvent un formidable microcosme de la diversité de nos sociétés. Au nom du Dieu qui a voulu réconcilier en lui toute la création, il nous est possible de mettre à profit cette réalité pour faire de nos Églises un laboratoire du rapprochement dans des sociétés où l’on s’éloigne toujours plus de ceux qui ne pensent pas comme nous.
Mais encore faut-il pour cela parvenir à dialoguer.
Une modeste expérience personnelle
Nous revenons en somme à cette crainte de voir nos relations se distendre ou nos communautés exploser si nous abordons certains sujets. Et le risque est bien réel.
Néanmoins, j’aimerais aussi témoigner d’une expérience différente. Comme nous tous, j’ai autour de moi des frères et sœurs dont je sais que nous différons clairement au sujet de diverses questions. Nous n’avons pas les mêmes présupposés. Nous ne nous exposons pas aux mêmes sources d’information. Nous aboutissons à des conclusions différentes. Et pas qu’en matière politique. Voilà bien le genre de personnes à l’égard desquelles on pourrait être tenté de cultiver une certaine « ignorance fraternelle » permettant de préserver le minimum requis d’unité chrétienne. Il faut bien dire que, selon les tempéraments et les sujets, telle est peut-être parfois l’attitude la plus sage. On ne peut pas tout faire de la même manière avec tout le monde.
Cependant, j’ai trouvé un réel intérêt à pouvoir entrer en dialogue avec certains de ces frères et sœurs sur des sujets qui pourraient être délicats. Mon but n’est pas de les convaincre de quoi que ce soit, mais d’entendre la vision du monde qui est la leur, de mieux les comprendre. Il s’agit d’abord de laisser place à la complexité et de contrecarrer un peu les biais qui peuvent être les miens. J’écoute attentivement et m’assure d’avoir bien compris. Je recherche et valorise ce qui nous est commun. J’interroge sincèrement pour mieux comprendre ce qui m’étonne ou m’intéresse. Nous partageons certaines ressources qui nous ont interpellés.
J’ai d’ailleurs récemment été encouragé à ce sujet par un article intitulé « Comment aborder Dieu ou la politique dans un monde polarisé ? », publié par le magazine Christianity Today. Un spécialiste en gestion de conflits y propose quelques pistes pour envisager ce type de conversations.
Pour ma part, ces conversations n’ont bien souvent pas fondamentalement changé mes positionnements. Et la chose est probablement réciproque. Tel n’est au fond pas le but ultime : dans l’Église comme en politique, il faut aussi une certaine diversité pour ne pas s’égarer dans une vision monomaniaque et simpliste de la réalité. Mais mon regard s’est affiné, nuancé, et je me permets d’espérer que cela aussi est réciproque.
Protéger notre unité
Quoi qu’il en soit, l’effet le plus précieux de ces conversations, me semble-t-il, est le sentiment d’un rapprochement à l’égard de ces frères et sœurs, le sentiment de mieux les comprendre, de mieux comprendre leurs préoccupations profondes, souvent en fait très semblables aux miennes. Les hommes de paille que pourraient représenter certaines idées qui m’inquiètent profondément prennent soudain corps, et ce corps est celui de frères et sœurs bien-aimés en Christ. Nous ne sommes toujours pas d’accord sur tout, mais je crois que nous nous comprenons mieux et sommes davantage en lien. L’unité entre nous s’en trouve protégée, sinon approfondie.

Avant d’être de gauche ou de droite, ou de quelque autre nuance qui vous plaira, nous sommes tous des chrétiens faillibles et souvent désorientés dans un monde qui l’est lui aussi. Si les informations auxquelles nous nous exposons nous laissent prétendre que tout va bien dans les mouvements dont nous nous sentons proches ou, au contraire, que tout est à jeter dans ceux que nous percevons comme antagonistes, nous ne vivons probablement plus dans la réalité. Mais l’Église nous offre une chance d’y revenir et de nous y maintenir.
Bien au-delà de ma petite expérience à l’échelle individuelle, la sécurité en Dieu que nous procure l’Évangile nous équipe pour développer une véritable culture de l’écoute et du dialogue sans lesquels nous ne ferons que nous éloigner, quand bien même nous préserverions les apparences de l’unité. Que ce soit en politique ou ailleurs, si nous ne pouvons pas travailler ensemble à mettre l’Évangile en relation avec les sujets qui nous tiennent le plus à cœur, comment espérer qu’il nous transforme en profondeur ? En gardant les yeux fixés sur l’essentiel et en apprenant à dialoguer — bien des ressources existent pour le faire — nos communautés peuvent encourager et développer des espaces de conversation sincère et ouverte pour continuer à promouvoir la paix de Christ dans un monde en proie aux déchirements.
Il ne s’agit pas de rêver à la création de la société parfaite ici-bas, dans l’Église ou dans nos États. Nous nous réjouirons bien sûr des avancées que nous pourrons peut-être porter autour de nous. Mais avant tout, notre souci est d’apprendre à mieux nous aimer de l’amour de Jésus-Christ et d’en rendre témoignage à notre monde. Pour cela, il nous faut aussi apprendre à résister ensemble aux enfermements qui pourraient nous laisser silencieusement dériver toujours plus loin les uns des autres.
« En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l’amour. Efforcez-vous de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. » (Éphésiens 4.2-6).
(*) Cette expression relative à l’alliance objective entre l’armée et l’Église est attribuée à Georges Clémenceau. Le goupillon qui symbolise l’Église est un objet liturgique servant à asperger les fidèles d’eau bénite.