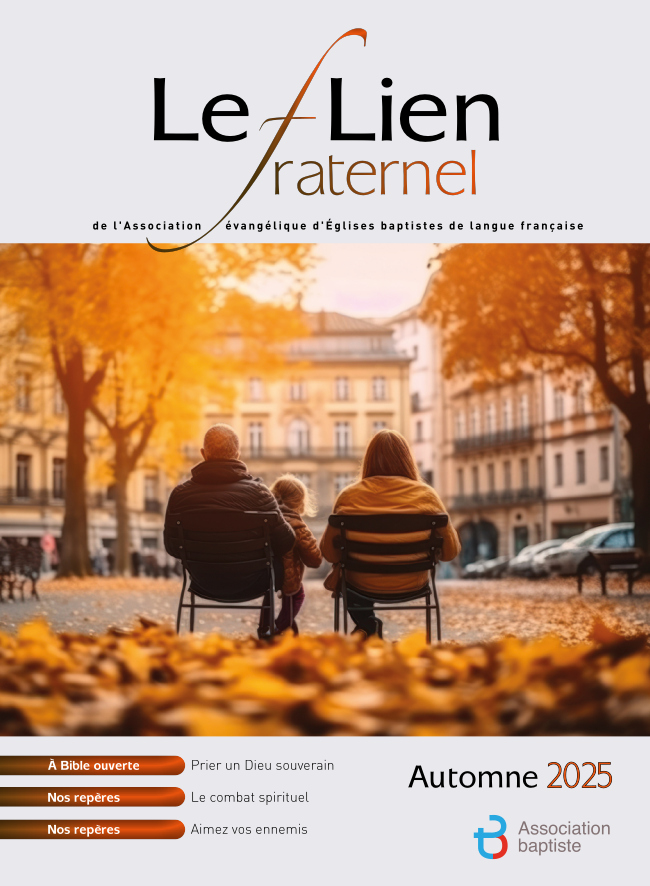Joyeux anniversaire Nicée !

Il y a mille sept-cents ans, l’empereur romain Constantin invitait les élites épiscopales au premier concile œcuménique qui se tint à Nicée (l’actuelle Izmit, en Turquie) du 20 mai au 25 juillet 325.
Claire Reggio, spécialiste de l’antiquité tardive et du christianisme, nous relate cet événement dans son ouvrage Nicée, 1700 ans d’histoire. Elle le fait avec talent et précision en s’appuyant sur les sources dont nous disposons (correspondances, décrets, récits) et en analysant les enjeux et les suites de cette rencontre.
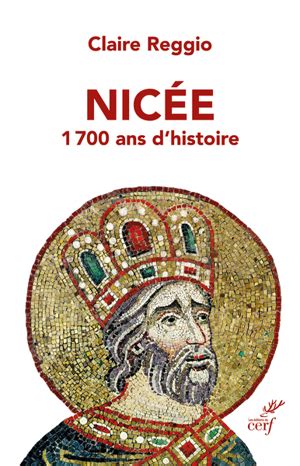
Elle commence par dresser un tableau de la situation historique et religieuse des siècles passés. Comme Constantin, plusieurs de ses prédécesseurs ont cherché à unifier l’empire en instaurant une religion d’État. S’ensuivirent des persécutions envers les chrétiens qui refusaient de se soumettre. Il faut attendre l’Édit de Milan en 313, promulgué par Constantin, pour que le christianisme soit autorisé au même titre que les autres religions, voire privilégiée. S’il adopte la foi chrétienne, même rudimentaire, il ne sera baptisé que sur son lit de mort. Pour lui, la foi chrétienne peut être un ferment d’unité d’un empire immense.
Ce n’est pas pour autant que la paix s’installe. L’autrice nous montre combien les persécutions ont divisé les chrétiens. En effet, certains, les lapsi, avaient cédé, sacrifiant aux dieux romains. Que faire des repentants après coup ? Pour l’évêque Donat et ses disciples, la validité des sacrements dépendait de la sainteté du ministre qui les dispensait. Il fallait donc rebaptiser ceux qui avaient reçu le sacrement d’un évêque failli. Cela entraîna une grave crise. La question fut tranchée au concile de Rome en 312, mais la discorde perdura jusqu’au VIIIᵉ siècle.
Constantin, comme nous l’explique Claire Reggio, n’est pas au bout de ses peines. Il doit affronter une dissension autrement importante : la crise arienne. La thèse d’Arius, prêtre d’Alexandrie se résume ainsi : « Le Fils est-il Dieu comme son Père ? Est-il un être divin distinct du Père ? À moins qu’il ne fut la première créature de Dieu ? » C’est de toute la christologie, encore faiblement élaborée, qu’il s’agit : la divino-humanité du Fils. L’autrice attire notre attention sur le fait que ces questions enflamment tout le monde et qu’on en discute jusque dans les rues et les commerces. Or pour le gouvernement impérial, le consensus des évêques est nécessaire pour assurer la paix. Il faut donc qu’il y ait alliance entre le trône et l’autel et que le désaccord théologique soit réglé. C’est une des raisons pour lesquelles le concile est convoqué.
Claire Reggio nous le décrit comme un drame antique : convocation à toute la chrétienté ; arrivée des évêques de tous les coins de l’empire ; assemblée réunie ; empereur engageant le dialogue avec le « chœur des évêques » ; discours ; débats ; décrets et anathèmes ; clôture et banquet. On ignore combien il y eut de participants, les sources divergeant. On en retint finalement trois-cent-dix-huit (correspondance symbolique avec le nombre des serviteurs d’Abraham). Autre clin d’œil : les évêques se considéraient comme les successeurs des apôtres par référence à Actes 2.1-11 à cause de leur diversité et à Actes 15.28-29 à cause de leurs décisions consensuelles.
La question christologique est examinée attentivement. Il en résulte le symbole de foi (ou confession) qui est clairement anti-arien qui prend une forme doctrinale : « […] Et en un (seul) Jésus-Christ, fils unique engendré du Père, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu […] . » Arius ne peut y souscrire mais seuls trois autres évêques le suivront. Ils seront anathémisés et exilés. D’autres signeront pour éviter les représailles.
La question de la date de Pâques fut tranchée. C’était un motif de discorde entre ceux qui suivaient l’usage juif et ceux qui avaient le dimanche suivant la Pâque juive. Il fut décidé que la fête serait célébrée « au dimanche qui suit le quatorzième jour de la lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après ». Comme certains métropolites ne s’entendaient pas sur la date de l’équinoxe de printemps, le problème fut partiellement résolu.
Des questions de discipline ecclésiastique, de liturgie, celle de la réadmission des schismatiques furent scrutées. Le tout fut synthétisé dans vingt canons (décrets) qui furent adressés à toute la chrétienté.
Ce premier concile en inaugure toute une série au cours desquels les points doctrinaux furent repris, approfondis. Il y eut de nouveaux désaccords mais il nous faut être reconnaissants envers ceux qui ont « essuyé les plâtres » et ont dû élaborer au fil des ans les fondements de ce que nous croyons.
Cet ouvrage m’a vivement intéressée par ses renseignements précieux, ses renvois aux sources et leurs interprétations. Il présente un Constantin qui paraît sincère même s’il n’oublie jamais son intérêt et celui de l’empire.
Claire Reggio, Nicée, 1700 ans d’histoire (Cerf, 2025, 176 p., 20 €)