Post-scriptum
Avant que je n’oublie...
Fin de la première épître de Paul aux Thessaloniciens… Après les grandes questions sur la fin des temps, voici l’heure des recommandations diverses, des P-S, des « avant que je n’oublie ». En quelques mots, nous pourrons regarder derrière les coulisses, entrer dans l’intimité de cette Église du Ier siècle dans ce qu’elle a de plus ordinaire. Non pas les grosses difficultés et les controverses, mais le quotidien.
[ Dans votre Bible : 1 Thessaloniciens 5.12-28 ]
Nous examinerons les différents P-S de ce texte en essayant de déterminer quels sont les plus importants. Avant d’aller plus loin, pourquoi ne pas lire vous-même le texte et tenter de repérer les éléments qui vous semblent les plus saisissants ? Au risque de ne pas trouver les mêmes que moi, osez l’exercice !
Le respect des responsables reconnus
Le premier P-S concerne « ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur », aux versets 12 et 13. J’apprends ici trois choses. Premièrement, cette Église qui n’avait que quelques mois d’existence comptait déjà des conducteurs. Elle avait une structure. Passé un certain seuil, tout groupe humain s’organise autour de responsables. Ils peuvent parfois, malheureusement, s’imposer par la ruse ou la violence. Ils peuvent gagner le respect de tous par leur travail et leur compétence. Ils peuvent être nommés par une autorité extérieure. Ils peuvent être élus. Dans tous les cas, au-delà d’une petite dizaine de personnes, l’avis d’une ou deux comptera plus que celui des autres. Les Églises du Nouveau Testament ont des responsables.
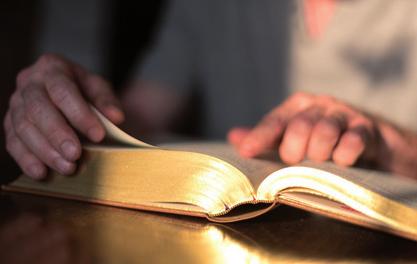
Deuxièmement, ces responsables à Thessalonique travaillaient à l’enseignement de la Parole de Dieu et à l’élaboration de la vie de l’Église. Un corps s’organise : « On se réunit quand ? Où ? Pour quoi faire ? » « Ils vous dirigent au nom du Seigneur », dit l’apôtre. Puis il cite un autre aspect du ministère des responsables : « Ils vous avertissent. » Ils se préoccupent de la santé spirituelle et morale des chrétiens et l’évoquent dans les prédications publiques ou dans des entretiens particuliers.
Troisièmement, pourtant, ce P-S nous apprend que le ministère des responsables de Thessalonique n’était pas reconnu par tous. « Appréciez-les, montrez-leur une grande estime, montrez-leur de l’affection, vivez en paix. » J’imagine que certains chrétiens ne se privaient pas de critiquer, de contester, de n’en faire qu’à leur tête, sans respect ni amour. Pourquoi ? Les responsables ne partageaient peut-être pas leur vision exaltée de la fin du monde ou essayaient de les ramener à une vie sobre, dans le respect du travail et du mariage. Ou pour d’autres raisons encore.
Que se passe-t-il si nous ne tenons pas compte de ce premier P-S ? L’Église devient un panier de crabes. Elle ressemble à une équipe de foot, sans doute composée de brillantes individualités, mais sans leader ni cohésion. C’est une équipe perdante.
« Nous vous demandons, frères et sœurs, d’apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. »
Ceci m’amène tout droit à un deuxième P-S.
Vivre en Église, c’est vivre en relation
Aux versets 14 et 15, nous rencontrons pour la deuxième fois le verbe « avertir ». Autre signe qu’il y a des problèmes. Ce qui est nouveau est que Paul demande à tous d’avertir ceux qui ont une vie corrompue. La version Semeur 2015 insiste sur le fait que les « frères et les sœurs » ont le devoir « d’avertir ceux qui mènent une vie déréglée, de réconforter ceux qui sont découragés, de soutenir les faibles, d’être patients envers tous ». Cette thématique est très courante dans le Nouveau Testament. Nous sommes solidaires les uns des autres et, à ce titre, nous nous exhortons, nous édifions, nous pardonnons, nous aidons les uns les autres. En un mot, nous nous aimons réciproquement.

Qui peut être contre cela ? C’est la conséquence logique de notre intégration dans le corps de Christ. Je deviens en effet le gardien de mon frère. Son bien-être me concerne. Qui peut être contre ces relations fraternelles fortes ? En fait, deux sortes de personnes très différentes. Tout d’abord celles qui ont quelque chose à cacher. Elles veulent une religion sans engagement ni relation et n’ont rien compris au plan de Dieu pour le chrétien et pour l’Église.
Par ailleurs, on trouve aussi celles que la vie en Église a blessées. En effet, les bons conseils de certains chrétiens ne sont pas toujours appropriés. Leur sollicitude ressemble parfois à une intrusion. La discrétion et la confidentialité ne sont pas toujours respectées. Vivre en relation au sein d’une Église, cela s’apprend. Quand les relations sont abîmées, il faut travailler à les réparer. « Vivez en paix entre vous. » Ce n’est pas une option. C’est un ordre.
Que se passe-t-il dans une Église où les gens ne développent pas de relations saines entre eux ?
C’est le règne de la froideur, du formalisme, de l’individualisme. C’est, pour le monde extérieur, une raison de plus de ne pas croire en Christ. Car c’est à l’amour que nous avons les uns pour les autres que les gens reconnaîtront que nous sommes ses disciples (Jn 13.35).
« En toute occasion, recherchez le bien, dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. »
L’Esprit qui parle
Je vais passer sur la joie, la prière, et la reconnaissance des versets 16 à 18, pour m’attarder sur ce qui suit, aux versets 19 à 22. La version Colombe de 1978 traduit ainsi : « N’éteignez pas l’Esprit ; ne méprisez pas les prophéties ; mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ; abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. »
Paul est assez lapidaire. Éteindre l’Esprit ? Le Saint-Esprit est comparé à un feu ou à une lumière qui agit dans l’Église. Dans quels domaines ? Paul pointe ici les prophéties.
Voilà un mot qui donne du fil à retordre aux traducteurs. En français moderne, une prophétie, c’est une prédiction. Dans la Bible, c’est parfois cela mais, la plupart du temps, ce serait plutôt une exhortation, un mot d’ordre, un encouragement, un avertissement. La Bible en français courant appelle ces prophéties des « messages inspirés ». L’idée est que le Saint-Esprit inspire certains à formuler un message, des messages pour l’Église*.
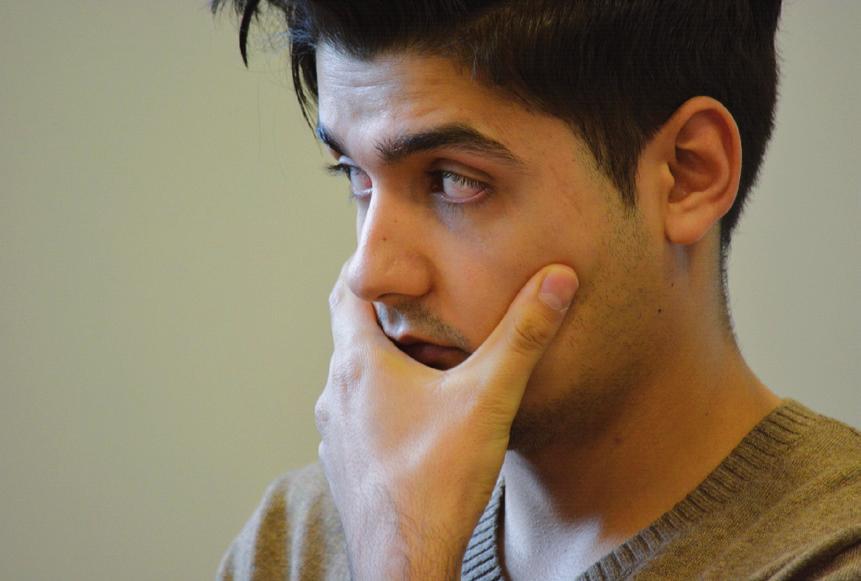
Néanmoins, ce n’est pas si évident que cela. D’une part, les Thessaloniciens seraient tentés de mépriser ces paroles. Mépriser un message qui vient de Dieu ? Justement : peut-être qu’il ne vient pas de Dieu. Peut-être qu’il vient de chrétiens qui se prennent pour le nombril du monde ; ou de ces farfelus qui annoncent que le retour de Christ est déjà survenu ; ou qu’il ne faut plus travailler parce que Christ est sur le point de revenir. Peut-être qu’il vient d’un chrétien bien intentionné qui se trompe... et qui mettrait tout le monde sur une fausse piste. Il existait manifestement à Thessalonique des prophéties-exhortations qui n’étaient pas fiables et amenaient certains chrétiens à mépriser toute interpellation, tout partage personnel, tout discours un tant soit peu improvisé. Non. Il ne faut pas écarter cette prise de parole. Il faut simplement l’examiner avant de l’accepter.
Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On ne se permettrait pas de juger une parole venant de Dieu. En revanche nous devons évaluer, trier, celles qui viennent des hommes. Nous ne gardons pas tout. Courte ou longue, préparée ou spontanée, calme ou passionnée... peu importe la forme, il faut que le contenu soit juste. Si nous discernons dans la voix d’un homme ou d’une femme le message de Dieu pour nous aujourd’hui, agissons en conséquence. Nous n’écrivons pas une nouvelle page dans la Bible. Nous percevons simplement mieux comment appliquer la Parole de Dieu dans la situation actuelle.
Une bonne prédication comporte une dose d’enseignement – les faits, et rien que les faits – et une dose prophétique : elle m’invite à agir. Ce n’est pas simplement un cours sur tel ou tel sujet biblique. C’est aussi un appel à l’action. Avant une prédication nous prions que Dieu inspire celui qui parle et ceux qui écoutent. Et l’Esprit fait son œuvre.

Je prends là l’exemple d’une prédication dominicale. Cela peut aussi se passer dans un groupe de quartier, dans une réunion de responsables et même dans des entretiens particuliers. Tout d’un coup ce qui est dit semble tellement évident et juste que nous y discernons un message d’en-haut. Que se passe-t-il dans une communauté qui ne tient pas compte de ce troisième P-S ? Deux choses.
Si une Église étouffe l’action de l’Esprit, cela signifie que personne n’accepte que Dieu l’interpelle, lui lance un défi ou l’appelle à la repentance. Seule la forme de la religion est maintenue. Personne ne progresse, grandit ou change.
Si c’est l’autre aspect du P-S, le discernement, qui n’est pas respecté, vous trouverez une Église où toutes les fantaisies sont possibles, où l’exagération est la règle, une Église en perpétuelle effervescence, sans stabilité, sans cap, sans doctrine.
« N’éteignez pas l’action de l’Esprit : ne méprisez pas les prophéties ; au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et gardez- vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. »
Conclusion
Y a-t-il un dénominateur commun à ces trois P-S que j’ai voulu un peu explorer ?
J’en vois un : l’importance de la parole humaine dans l’Église de Dieu. Ces responsables qui sermonnent, ces frères et sœurs qui avertissent et réconfortent, ces chrétiens qui parlent de la part de Dieu édifient l’Église par leurs paroles. Tantôt en public, tantôt dans des conversations privées. Le corps spirituel que constitue l’Église se construit par des relations et par des paroles.
Il ne s’agit pas de n’importe quelles paroles. Maladroites, amères, emportées, pessimistes, elles détruiront. Empreintes d’amour et conformes à la Parole de Dieu, elles édifieront.
J’ai annoncé que, dans cette toute dernière partie de l’épître, nous arriverions à voir derrière les coulisses. L’Église pourrait dévier. La désunion, la froideur, le formalisme, l’individualisme et l’illuminisme pourraient transformer la maison de Dieu en chambre froide ou en champ de bataille. Pourtant nous sommes ici devant une Église qui ne déviera pas. Paul la félicite pour sa foi, son espérance, son amour. Il attend le meilleur. C’est ainsi qu’il prie à la fin, pour que ses amis soient entièrement saints; qu’ils soient parfaitement gardés ; qu’ils soient irréprochables.
Un rêve ? Mais non ! L’apôtre, au verset 24, déclare : « Celui qui vous appelle est fidèle, et c’est lui qui accomplira tout cela. » Amen ! ■
(*) Sur le sens de la prophétie, cf. 1 Co 14.3,31. Sur la forme, cf. Ac 11.28 ; 21.11 (paroles courtes) et Ac 15.32 (des discours longs). Le cas d’Agabus en Actes 21 montre bien que la prophétie doit être évaluée, et que les interprétations peuvent diverger.

