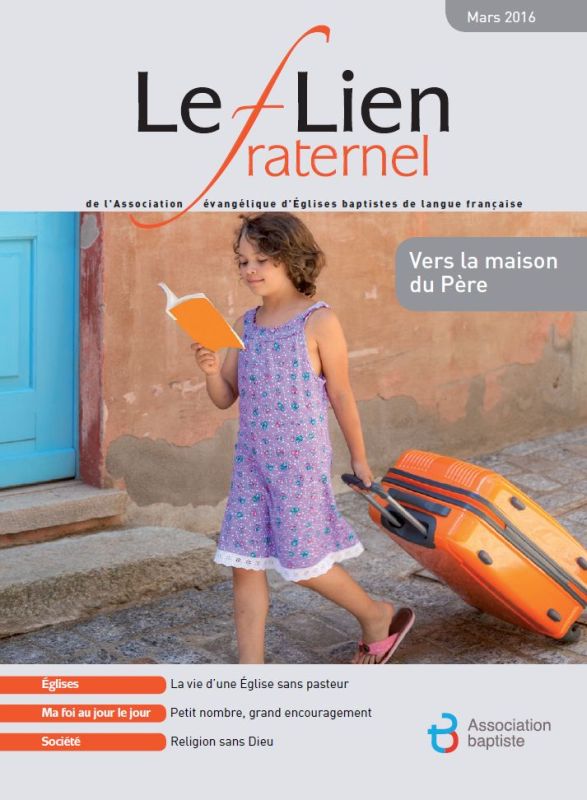Petit nombre, grand encouragement
Une Église locale est une communauté vivante. Ses membres se rassemblent notamment le dimanche matin, et vivent ainsi la force d’un groupe qui prie, chante, médite et commémore d’un commun accord. Le culte a cette fonction importante de nous faire ressentir notre appartenance au peuple de Dieu.
Mais tout ne se vit pas en grand groupe. Chaque personne a besoin de lieux plus intimes où les relations interpersonnelles sont plus faciles. La liberté de parole est plus grande, la timidité moins pesante, le dialogue s’établit plus naturellement.

La vie est ainsi façonnée dans cette oscillation entre le grand groupe et les relations personnelles. C’est de ces dernières dont j’aimerais parler. Et il faut trouver le bon ton : à trop les encadrer, les organiser, on finit par les étouffer ; mais si on imagine qu’elles se feront toutes seules, on pèche par optimisme. Dans une Église, il est donc opportun d’offrir un choix de formules possibles parmi lesquelles les personnes pourront trouver chaussure à leur pied ou adapter une idée à leur situation… à moins qu’elles inventent autre chose.
On peut citer différentes formules. Le parrainage au baptême, par exemple. Lorsqu’une personne se fait baptiser, elle choisit, selon ses affinités et en accord avec le collège pastoral, un ou deux parrains ou marraines. Et pendant au moins une année, à Mulhouse, ces derniers offrent un accompagnement fraternel au baptisé, au moyen de rendez-vous réguliers, d’appels téléphoniques, etc.
Autre exemple : le binôme de croissance. Le concept est simple, une fois encore : deux personnes, des amis, des voisins, des collègues, se retrouvent régulièrement pour prier ensemble, se donner des étapes à franchir, des défis de lecture biblique, partager des choses lourdes à porter, des peurs ou des doutes. Autant dans le parrainage se retrouve assez l’idée de l’enseignant-enseigné, autant dans ce binôme domine l’idée de l’égalité.

Encore un exemple : des petits groupes autour d’une idée simple. Les groupes de maison servent, entre autres, à faire la place aux relations interpersonnelles, dans lesquelles ils jouent un rôle important. Mais on peut imaginer d’autres groupes autour d’activités qui rassembleront des personnes très différentes les unes des autres, et qui feront à leur manière la place à ces relations : le jardinage, le travail du bois, le patchwork, des actions de solidarité, des anniversaires, des balades, de la musique, etc. Certes, ce ne sont pas des actions typiquement ecclésiales. On peut même s’en offusquer. Mais il ne faut pas conclure trop vite !

À vrai dire, ces groupes partent d’une certaine idée de l’Église locale : l’Église comme lieu de vie, lieu où l’on vient pour faire quelque chose que l’on aime faire, ou qui a du sens, que l’on soit chrétien ou non. Il s’agit là d’une manifestation toute simple de notre art de vivre en tant que communauté chrétienne, auquel nous invitons les personnes qui y trouvent un intérêt. Bien évidemment, les relations doivent être soignées. Car il s’agit bien de notre témoignage chrétien dans une société qui manque de repères et de lieux paisibles. Même si ce témoignage est déjà une fin en soi, ces groupes sont aussi, à leur manière, autant de portes d’entrée dans l’Église que certaines personnes choisiront peut-être un jour de franchir.
Le rôle des responsables de l’Église est tout d’abord celui de l’impulsion. C’est à eux de donner aux chrétiens de l’Église locale cette idée de leur communauté. C’est aussi à eux de donner une certaine idée des relations entre chrétiens : des relations vraies, sans artifices, tissées dans le quotidien et pas réservées à la sortie du culte. Ce sont les responsables qui donneront l’idée de base de ces binômes et petits groupes, à savoir l’encouragement mutuel, l’exhortation, la prière à deux ou trois ou simplement une action précise. Ils proposeront pour cela des formules faciles à mettre en œuvre. Ils doivent rester modestes, car ils n’ont pas le monopole des bonnes idées. Ils doivent aussi faire confiance, car le contenu de ces binômes ou petits groupes leur échappe nécessairement. Ils doivent aussi, paradoxalement, rester vigilants, car justement, il peut survenir des relations dommageables.
Je termine par des choses délibérément informelles : à deux ou trois, aller au cinéma, déguster un capuccino dans un café, ou simplement passer la pause de midi dans un parc public, un sandwich à la main. Ces choses ne sont pas réservées à nos fréquentations « hors Église » ! Quel bonheur de discuter du Sermon sur la montagne, alors qu’on est simplement assis sous un arbre avec un frère dans la foi, ou d’évoquer la bénédiction de Dieu avec une sœur, sur une terrasse en ville ! Si la circonstance peut sembler légère, le dialogue peut être profond.
On l’aura compris : le dialogue et les relations humaines doivent être promus dans nos Églises. Car l’implication dans une Église locale n’est pas que service. C’est aussi être ensemble. C’est être avec les autres. Et le savoir-être est facteur de croissance, par la grâce de Dieu. ■
PS : plusieurs des idées de cet article sont le fruit de la modeste mais bienfaisante expérience mulhousienne.