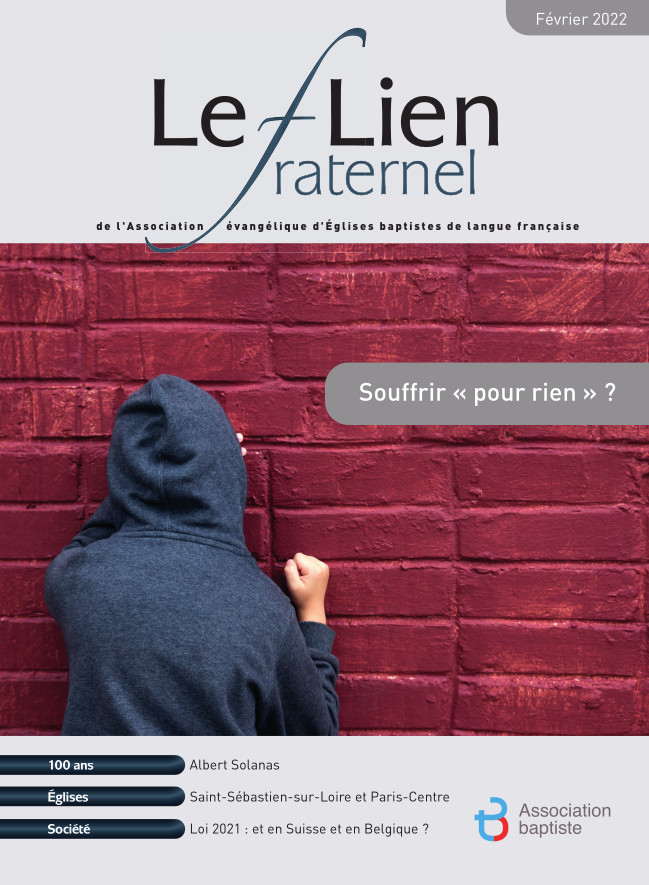Loi française de 2021 : des parallèles en Belgique ?
La Belgique ne connaît pas la « laïcité » au sens qu'on donne à ce terme en France. Il y a évidemment séparation de l'Église et de l'État, et un mouvement d'opinion croissant tend, comme en France et ailleurs, à réduire la dimension religieuse au seul domaine privé.

Ainsi, en communauté française, le remplacement des cours confessionnels par un cours spécifique de philosophie et de citoyenneté, recouvrant une approche transversale des différentes religions, est programmé dans l'enseignement officiel, mais n'est pas obligatoire pour l'enseignement libre confessionnel (très développé en Belgique, surtout par le réseau des écoles catholiques de taille presque égale à celle de l'enseignement officiel, mais qui comporte également quelques écoles protestantes-évangéliques). Ce remplacement n'est pas à l'ordre du jour en communauté flamande ni germanophone.
En Belgique, les Églises sont des associations de fait sans personnalité juridique, souvent doublées d'une association sans but lucratif avec personnalité juridique propre pour leurs affaires séculières. Certaines, rares, Églises évangéliques sont, à l'instar des paroisses catholiques, reconnues par l’État, entraînant un financement public des postes pastoraux, sans que leur titulaire soit pour autant considéré comme fonctionnaire public. Ceci explique qu'à ce jour, aucune pression tangible ne s'est encore manifestée quant au discours et à la pratique de ces Églises subsidiées au regard du principe de non-discrimination fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle, qui restent couverts par la liberté de culte et d'opinion tant qu'ils ne constituent pas un appel ouvert à la violence ou à la haine.
La question du port du voile par les enseignants donne également lieu à des débats, mais les cours et tribunaux suivent en général la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, en particulier l'arrêt du 15 juillet de cette année sur la licéité de principe d'un code vestimentaire fondé sur la neutralité confessionnelle si celle-ci répond à des intérêts réels et objectifs.
Enfin, la tentative de débat sur les « valeurs de l'identité nationale », entamée au lendemain des attentats de 2016, a fait long feu, de sorte qu'une loi comme celle d’août 2021 en France ne semble pas pour demain...