D'où vient votre lumière ?
Année après année, les illuminations le long des grands boulevards de nos villes m’émerveillent toujours autant. Cependant de nos jours, comme en contraste avec les splendides lumières de cette saison, plusieurs communes cherchent à économiser l’électricité. On réduit l’éclairage public à certains endroits, à certaines heures. J’y vois une occasion de reprendre conscience du poids de l’obscurité ! Quoi que vous vouliez faire, il faut de la lumière ! Mais en matière spirituelle, toutes les lumières ne se valent pas !
Une obscurité bien réelle
Noël recèle bien des vérités, mais la première d’entre elles pourrait bien être celle-ci : le monde est un lieu sombre et nous ne pourrons jamais y trouver notre chemin et percevoir la véritable réalité si Jésus ne nous éclaire. La célèbre prophétie d’Ésaïe 9 parle bien de cela : un monde qui marche dans les ténèbres dans l’attente d’une lumière. Matthieu voit la venue de Jésus comme une réponse à cette attente (Mt 4.16).
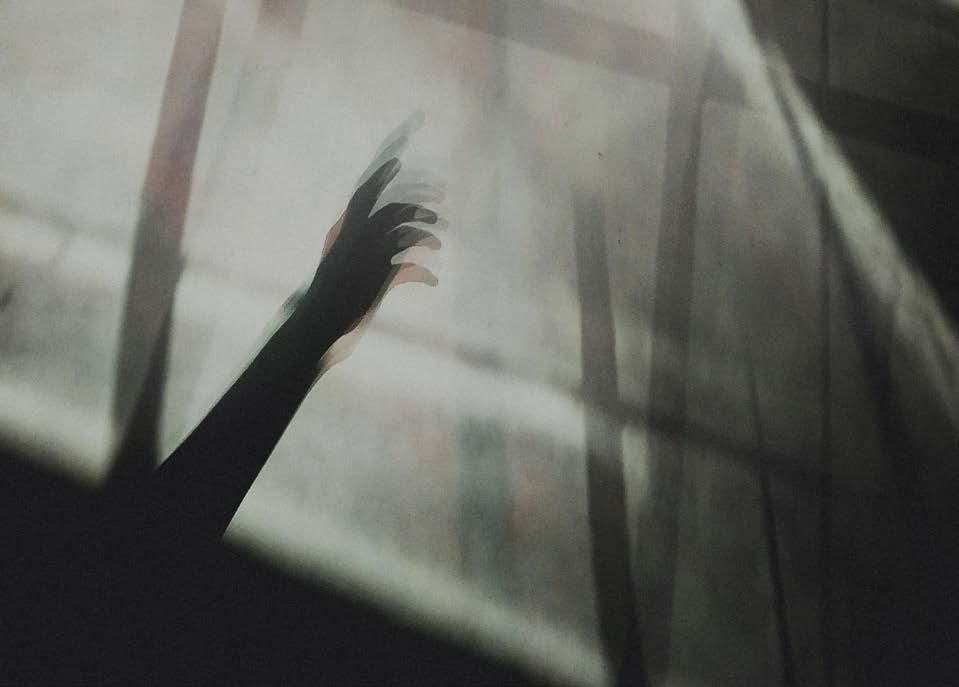
L’apôtre Jean, lui, écrit à propos de Jésus : « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l’a pas reconnue. » (Jn 1.9-10). Le Créateur du monde est venu en ce monde et, pourtant, la grande majorité des hommes ne l’a pas reconnu, accueilli ! Cette obscurité dont nous parle l’Écriture renvoie à la fois au mal et à l’ignorance qui emplissent ce monde.
Les Évangiles n’occultent pas cette réalité ! Marie, sur le point d’accoucher, doit trouver refuge dans une étable ! Les humains, sommet de la création, faits en « image de Dieu », ne font aucune place à leur Créateur ! Pas d’espace pour un couple pourtant livré à la dernière extrémité.

Et ce genre d’obscurité perdure. Même dans nos beaux pays tellement attachés aux droits humains, des hommes, des femmes et des enfants dorment dehors en plein hiver ! Au sud de l’Europe, la Méditerranée, qui attire chaque année des milliers de touristes, est devenue un véritable cimetière !
Je vous fais grâce du nombre de familles déchirées, des abus de pouvoir, des réfugiés abandonnés, délaissés, des viols, des guerres, etc.
Nos « lumières » humaines
La fin du chapitre 8 d’Ésaïe nous offre encore quelques plongées dans cette obscurité, dont le chapitre 9 annonce la fin. On y découvre le peuple d’Israël s’aventurer vers les spirites pour obtenir des réponses, maudire son Dieu et tourner son regard vers une terre dévastée (Es 8.9-22).
Le monde s’en remet à ses « experts », ses philosophes, ses scientifiques, ses politiques, ses « tireurs de cartes » pour trouver des solutions. « Oui, nous sommes dans l’obscurité, mais nous pouvons la vaincre par nos propres moyens. »
Et on multiplie les réunions, les commissions et les colloques, les rapports et les COP… Certains s’en remettent à l’État – c’est à lui de résoudre toutes les difficultés. D’autres comptent sur les marchés financiers. Presque tous placent leur espérance en la technologie : à la limite, si on bousille la terre, les plus riches pourront toujours déménager sur Mars…
Il y a quelques années, à la une d’un journal, on pouvait lire : « Le message de Noël est que l’amour triomphera, et que nous réussirons à créer un monde d’unité et de paix. » Vraiment ?
Certains d’entre vous se souviennent peut-être de Vaclav Havel, ancien premier ministre tchèque, grand penseur et leader de la fin du XXᵉ siècle. Son histoire personnelle lui offrait un regard doublement critique sur le communisme et le capitalisme : aucun de ces deux systèmes ne pourrait régler les problèmes fondamentaux de l’humanité. Ni la technologie, ni l’État, ni les marchés économiques ne pourraient nous épargner un conflit nucléaire, prévenir les violences ethniques ou la dégradation de notre environnement. « La recherche d’une vie meilleure ne sauvera pas l’humanité, de même que la démocratie seule n’y suffira pas. Il faut se tourner vers Dieu et le rechercher », déclara-t-il un jour.
En réalité, le fait de croire que nous pouvons nous sauver nous-mêmes, qu’un système politique ou une idéologie peut remédier aux problèmes humains, ou encore que la science pourrait leur apporter le bonheur, ne fait que rendre l’obscurité plus épaisse !
Et si, au bout du compte, comme le philosophe Bertrand Russel, vous pensez qu’il n’y a pas de Dieu, les choses deviennent encore plus sombres. Voici ce qu’il écrit(1) : « Dans ses grandes lignes, la vision du monde que la science nous offre est tellement plus vide de sens encore et tellement dénuée de but, que l’homme est le produit de causes sans aucune intention préalable ; que son origine, son développement, ses espoirs et ses peurs, ses amours et ses croyances ne sont que le résultat fortuit de la proximité entre atomes ; qu’aucune flamme, aucun héroïsme, aucune intensité de la pensée ou des sentiments ne peuvent prolonger la vie d’un individu au-delà de la tombe ; que tous ses travaux à travers les siècles, toute la brillance éclatante de son génie, sont destinés à disparaitre avec l’effondrement du système solaire, et que l’ensemble de l’édifice des réalisations humaines sera enterré sous les décombres d’un univers tombé en ruines. […] Ce n’est qu’en prenant appui sur le cadre de ces vérités, sur les fermes fondations du désespoir absolu qu’il est envisageable de construire une demeure pour l’âme.
Puisque la réalité n’est qu’une mécanique dénuée de sens, provenant du hasard et allant vers le néant, notre âme ne devrait avoir, selon Russel, qu’une habitation : le désespoir. Vous avez dit obscurité ?
On voit bien là ce que l’on peut lire en Ésaïe 8 : si l’on regarde seulement vers la terre et les ressources de l’humanité, l’obscurité ne fait que s’épaissir.
La lumière nous vient d’ailleurs
Le christianisme s’oppose aux penseurs optimistes qui soutiennent que nous pourrions régler tous les problèmes si nous y travaillions sérieusement. Mais il ne soutient pas non plus la vision des pessimistes qui n’ont à offrir qu’un futur catastrophique.
Ésaïe 9 nous parle de lumière mais n’affirme pas qu’une lumière a jailli du monde. Elle s’est levée sur lui. Elle est venue de l’extérieur. Cette lumière, c’est Jésus (Jn 8.12).
L’image d’un soleil levant pour évoquer la lumière de Dieu est d’une grande profondeur. La lumière du soleil est pour nous source de vie, de vérité et de beauté.
Sans soleil, rien ne pourrait venir à l’existence, et notre vie même serait menacée ; nous ne pourrions pas survivre dans un désert de glace. De la même manière, qu’on croie en son existence ou pas, c’est Dieu qui donne à chaque être humain « la vie, le mouvement et l’être » (Ac 17.28).
Le soleil nous permet également de percevoir la réalité des choses, la vérité de ce qui est ; il met tout en lumière. De la même manière, Dieu est la source de toute vérité (1Jn 1.5-6).
Et enfin, le soleil est beauté. Ce n’est pas pour rien que tant de gens aiment l’été, les longues journées ensoleillées. Elles mettent en valeur la splendeur de la création, mais aussi notre joie d’être vivants. Nous avons besoin de lumière pour être heureux ; et ce ne sont pas ceux qui souffrent de dépression saisonnière qui me contrediront…

Comme le disait si bien Saint Augustin(2) : « Notre cœur est inquiet tant qu’il ne repose pas en toi. » Augustin avait la conviction que lorsque nous éprouvons de la joie pour une raison ou l’autre, Dieu en est en fait la source réelle. Quelle que soit la chose ou qui que soit l’être que vous aimez ou qui vous procure de la joie, cette chose ou cette personne vient de lui, elle porte sa marque… Toute joie se trouve en Dieu, et tout autre chose qui peut vous réjouir ne fait à vrai dire qu’en dériver, car ce que vous cherchez vraiment, c’est lui, que vous en ayez conscience ou pas. La lumière nous vient de l’extérieur.
L’enfant qui éclaire nos ténèbres
Et cette lumière s’est manifestée sous une forme qui a de quoi nous étonner : « Un enfant nous est né. » (És 9.5). Cet enfant porte cependant des titres traditionnellement accordés à Dieu : « Père éternel – c’est-à-dire Créateur – Dieu puissant… » Et pourtant, il est né. Cet enfant est Dieu lui-même.
À ma connaissance, aucune religion n’a jamais professé que Dieu était né, qu’il avait souffert, qu’il avait fait preuve de courage, qu’il savait ce que c’était d’être abandonné par ses amis, d’être écrasé par l’injustice, d’être torturé et de mourir. Dans les premiers siècles de l’histoire de l’Église, un grand penseur, Origène, a écrit dans son Traité des principes : « De toutes les choses merveilleuses et splendides qui concernent Dieu, il y en a une qui transcende totalement les limites de la connaissance humaine. » Laquelle ? « La façon dont la grande puissance de la majesté divine a pu entrer dans le ventre d’une femme et naître sous la forme d’un petit enfant et pousser ces mêmes cris que font les enfants qui pleurent. »
Voici ce qu’écrit de son côté la romancière et autrice anglaise Dorothy Sayers(3) : « La signification de l’incarnation (de Noël) est que, quelle que soit la raison pour laquelle Dieu a choisi de nous laisser chuter, souffrir, être la proie du chagrin et de la mort, il a eu malgré tout l’honnêteté et le courage d’être lui-même le remède. Il ne peut rien exiger de l’homme qu’il n’ait exigé de lui-même. Il a lui-même subi tout ce qu’un être humain peut subir, des petites contrariétés familiales en passant par les affres d’un travail exténuant ou du manque d’argent, jusqu’aux douleurs les plus atroces, aux humiliations, aux revers, au désespoir et à la mort […] Il est né dans la misère, et a souffert mille morts pour nous. »
Ce bébé posé dans une mangeoire, quelque part dans Bethléem, n’est venu que pour nous montrer combien Dieu nous aime… Au point de se faire semblable à nous, et de mourir par amour pour nous.
Jésus est la lumière venue de Dieu en ce monde parce qu’il apporte une vie nouvelle qu’il veut substituer à notre mort intérieure. Il est le seul à pouvoir éclairer nos ténèbres, à pouvoir nous montrer notre cécité spirituelle, à pouvoir guérir nos blessures, à pouvoir sauver ce monde et en faire un paradis. Il est le seul à pouvoir nous révéler la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. Il est le seul qui marche à nos côtés lorsque nous traversons la vallée de l’ombre de la mort, là où personne d’autre ne peut nous accompagner…

En Jésus, Dieu s’est fait homme, il est devenu fragile et nécessiteux. Dieu a pu être touché. Dieu a pu être embrassé… Pourquoi a-t-il fait cela ? N’aurait-il pas pu nous aimer, vouloir notre bien, mais se tenir à distance ? Dieu voulait devenir intime avec nous. L’intimité, c’est l’expérience partagée. Dieu est devenu humain pour partager l’expérience de l’humanité. L’intimité demande de la proximité, de la vulnérabilité. Alors Dieu s’est fait chair. Il s’est mis dans notre peau.
Marie a porté Dieu dans ses bras, embrassé le visage de Dieu, allaité Dieu, caressé la tête de Dieu. En Jésus, Dieu a dû apprendre à marcher. Le Dieu qui a dit « Que la lumière soit… » a dû apprendre à parler. En Jésus, Dieu a été seul, Dieu s’est senti fatigué, Dieu a saigné, Dieu a traversé la puberté, Dieu a planté des clous et s’est tapé sur les doigts. En Jésus, Dieu a aimé, Dieu a ri, Dieu a souffert, Dieu a espéré, Dieu a vécu et Dieu est mort.
En Jésus, ce Dieu qui semblait distant, ce simple concept pour beaucoup, ce Dieu inaccessible, s'est fait réel et proche. Oui, il y a en lui de l’espoir pour toutes nos obscurités. Voilà quelle est la véritable lumière que nous célébrons à Noël !
(1) Bertrand Russel, Mysticism And Logic And Other Essays (Longmans, Green, and company, 1919), pp. 47-48, traduction Jean-François le Téno.
(2) Saint-Augustin, Confessions.
(3) Dorothy Sayers, The Greatest Drama Ever Staged, Creed or Chaos ? And Other Essays in Popular Theology (Hodder and Stroughton, 1940), p. 6.

